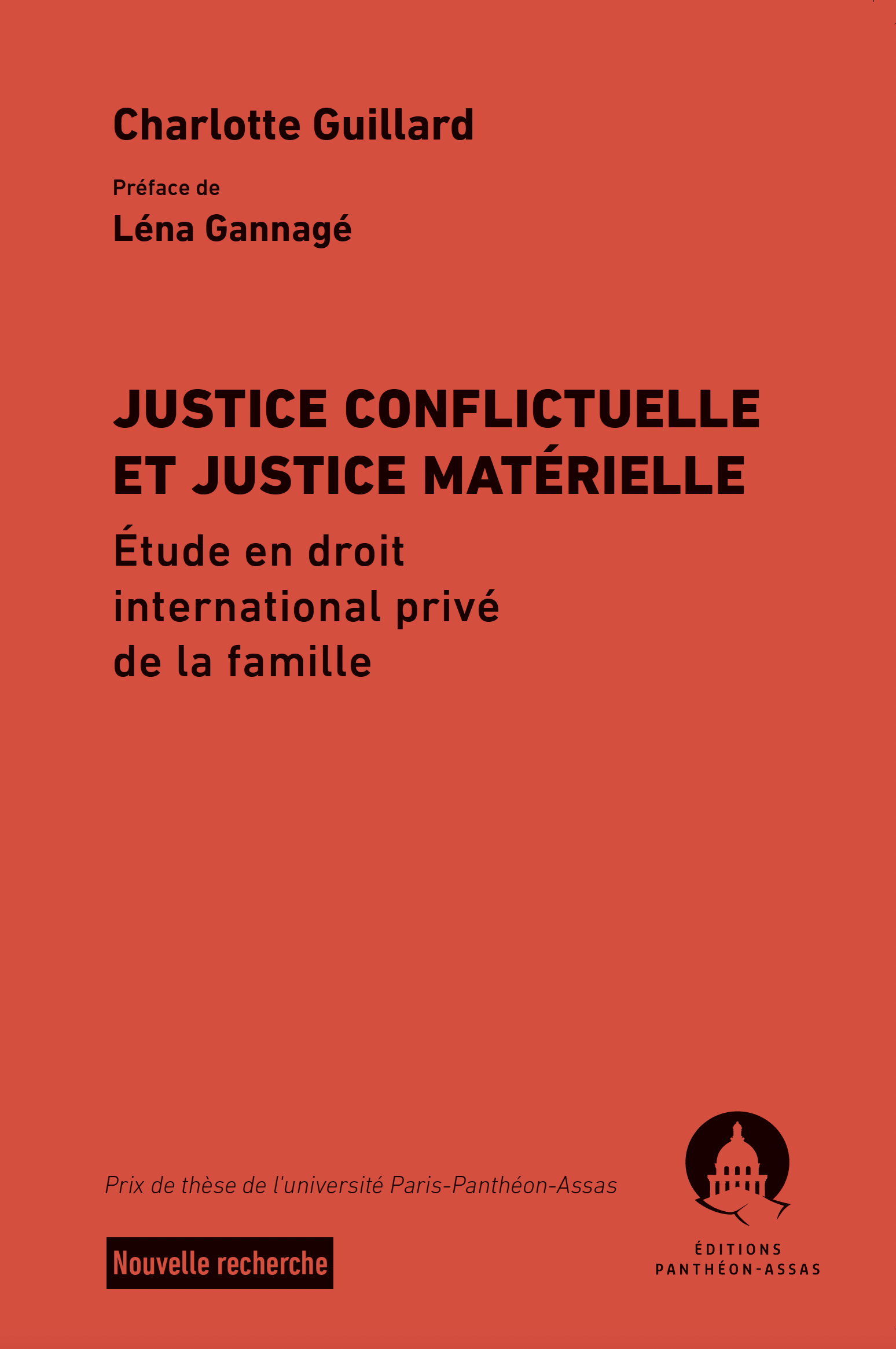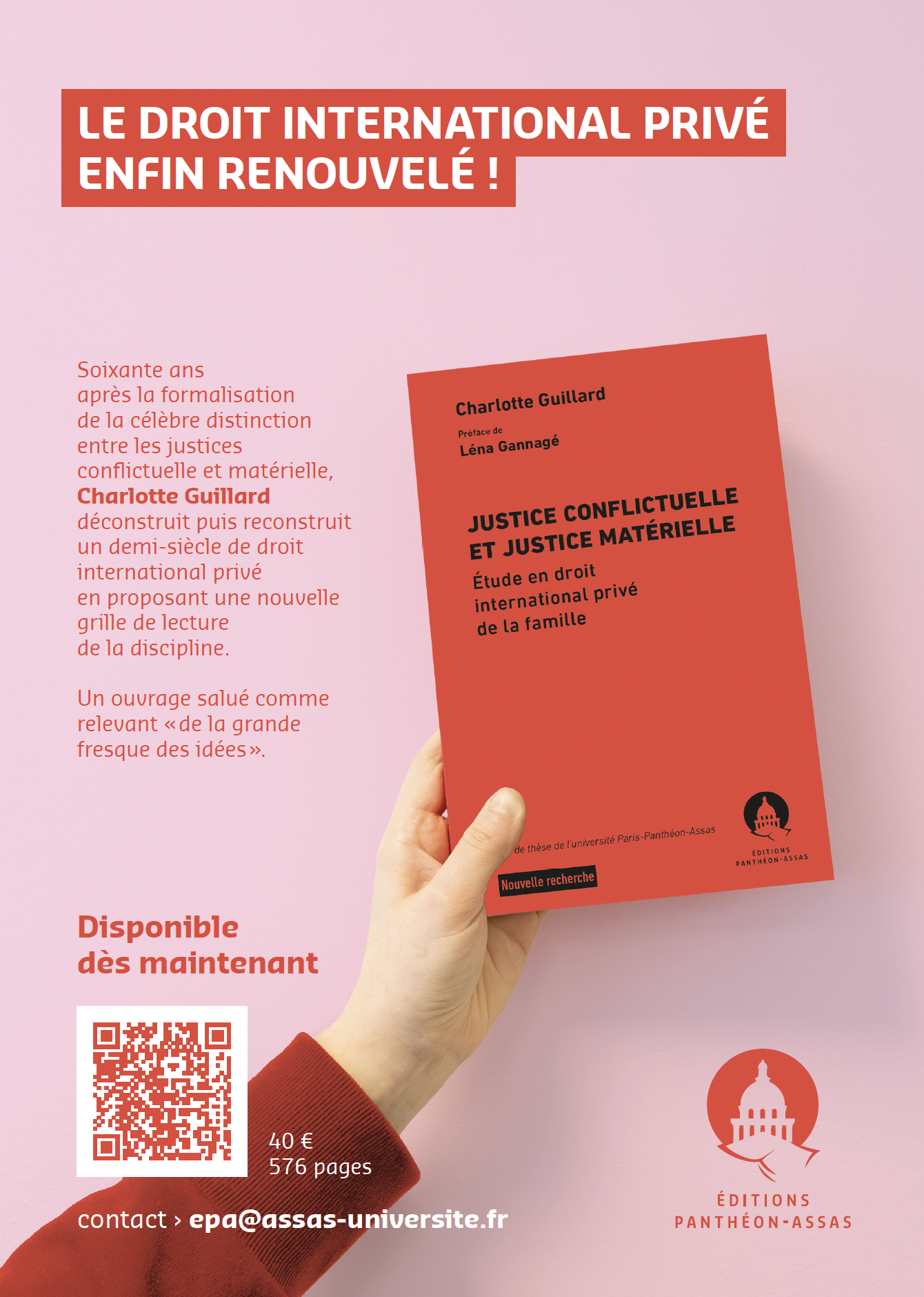- Université
- Formations
- Recherche
- International
- Campus
- Assas Executive
Justice conflictuelle et justice matérielle : entretien avec Charlotte Guillard
Recherche
Justice conflictuelle et justice matérielle : entretien avec Charlotte Guillard
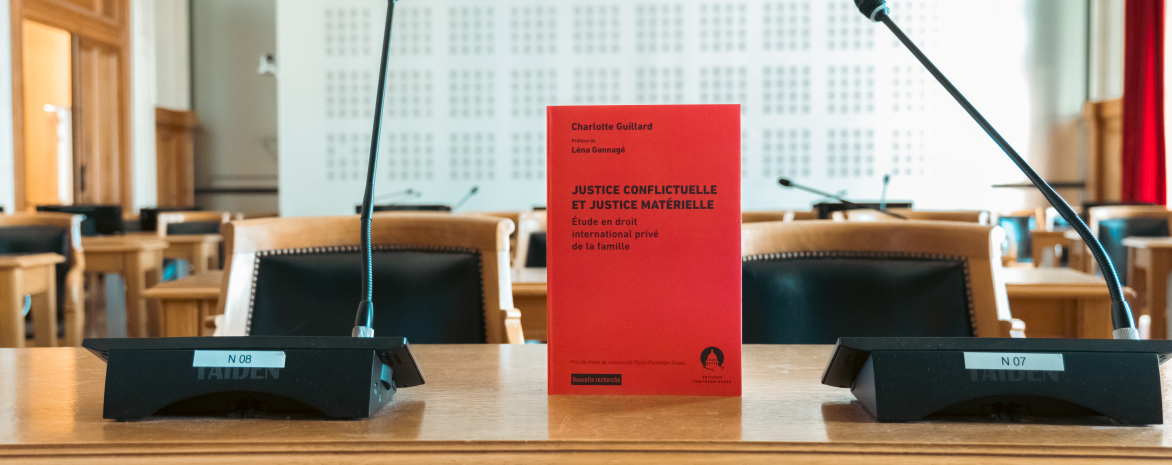
Rubrique recherche:
Temps fort:
L'ouvrage de Charlotte GUILLARD, préfacé par Léna GANNAGÉ, paraît le 8 juillet 2025 aux Éditions Panthéon-Assas
Les Éditions Panthéon-Assas publient ce 8 juillet la thèse de Charlotte GUILLARD, intitulée Justice conflictuelle et justice matérielle. Étude en droit international privé de la famille, et dirigée par Léna GANNAGÉ, professeur en droit privé à l’Université Paris-Panthéon-Assas.
Soutenue en 2021, la thèse de Charlotte GUILLARD a reçu le prix de thèse de l’Université Paris-Panthéon-Assas.
Pourriez-vous définir la distinction entre justice conflictuelle et justice matérielle ?
En tant qu’objet doctrinal, la distinction entre justice conflictuelle et justice matérielle se prête mal à une définition. On peut toutefois en résumer les enjeux. La distinction a été théorisée vers le milieu du XXe siècle par la doctrine européenne aux fins de répondre aux attaques, venues d’outre-Atlantique, à l’encontre de la règle de conflit de lois. Le point de départ de cette réflexion se trouve dans la question suivante : quelle est la loi la plus juste à appliquer aux relations affectées d’un élément d’extranéité ? Est-ce la loi la plus proche de la relation en cause ou bien est-ce la loi qui lui apporte la solution matérielle la plus satisfaisante ? Opter pour la première solution, c’est favoriser ce qu’on a appelé la justice conflictuelle, incarnée par la règle de conflit de lois de facture classique, c’est-à-dire bilatérale, neutre et abstraite. Se rallier à la seconde proposition implique de faire primer, en droit international privé, la justice dite matérielle, laquelle se manifeste par toutes les méthodes laissant une place aux considérations matérielles dans le traitement du conflit de lois. L’exception d’ordre public international incarne de la manière la plus flagrante cette justice, laquelle doit, dans la conception classique, n’intervenir qu’exceptionnellement en droit international privé. La thèse propose ainsi d’étudier, dans le détail, les termes et les enjeux de cette « alternative du juste » et d’interroger la pertinence du rapport de principe à exception entre la justice conflictuelle et la justice matérielle.
Qu’est-ce qui a motivé votre volonté de vous confronter, plus de soixante ans après sa formalisation par Gerhard KEGEL, à cette célèbre distinction ?
J’ai découvert cette distinction lors des séminaires de droit international privé de Léna GANNAGÉ en Master 2 et elle a immédiatement piqué ma curiosité. J’ai voulu approfondir la question et j’ai vite perçu, au gré de mes lectures, que la distinction de KEGEL s’inscrivait comme une référence chez une très grande majorité d’auteurs contemporains menant des réflexions de théorie générale du conflit de lois. Cette référence restait toutefois mystérieuse : d’un côté, la distinction m’a semblé s’inscrire comme une grille de lecture des objectifs et des méthodes de la discipline. De l’autre, le sens exact et la portée actuelle de la distinction entre les deux justices restaient difficile à saisir, au regard des profondes mutations ayant affecté le droit international privé depuis les travaux de KEGEL.
Quels sont, selon vous, les principaux bouleversements méthodologiques et/ou conceptuels qui ont rendu cette révision nécessaire ?
Ils sont nombreux. Sur le plan méthodologique, la discipline a changé de physionomie. Elle s’est, pourrait-on dire, matérialisée. L’intervention de plus en plus fréquente des lois de police, des règles de conflits à caractère substantiel, des droits fondamentaux ou encore des libertés de circulation du droit de l’Union européenne en sont autant de manifestations. Chacune de ces méthodes est orientée vers la satisfaction d’objectifs substantiels particuliers. Leur immixtion ébranle ainsi fortement la place de la règle de conflit comme méthode de résolution de principe du conflit de lois.
Conceptuellement, c’est d’abord le postulat traditionnel de la neutralité de la discipline qui est remis en cause. C’est ensuite, et plus fondamentalement, l’évolution des objectifs devant gouverner le conflit de lois et l’identification des valeurs devant orienter sa réglementation qui justifient une analyse renouvelée de la distinction. Autrefois tourné vers un idéal de coordination des ordres juridiques, le droit international privé est aujourd’hui davantage préoccupé par la promotion de la mobilité juridique des sujets de droit.
Pourquoi avoir choisi le droit des personnes et de la famille comme terrain d’analyse ?
Plusieurs raisons l’expliquent. Le statut personnel fournit un terreau fertile, en droit international privé, aux réflexions de théorie générale. Les décisions rendues par la Cour de cassation relatives à un problème de théorie générale du droit international privé sont là pour en témoigner : jeu du renvoi en matière de filiation, exception d’ordre public international en matière de gestation pour autrui, fraude en matière d’adoption, lois de police en matière de consentement au mariage… les exemples sont nombreux. Les droits fondamentaux et les libertés de circulation faisant intervenir les jurisprudences de la Cour européenne et de la Cour de justice trouvent également fréquemment à s’appliquer en matière personnelle et familiale et perturbent fortement la réglementation traditionnelle du conflit de lois.
Par ailleurs et plus fondamentalement, dès lors que le sujet interroge la place des valeurs en droit international privé, la matière familiale offre un angle d’analyse privilégié. C’est en ce domaine que les affrontements axiologiques sont le plus visibles et les moins faciles à résoudre en raison du particularisme encore très fort dans ce pan intime des relations sociales.
Enfin, à quel public recommanderiez-vous la lecture de votre thèse ?
La thèse s’adresse à un public averti sur les questions de droit international privé mais non exclusivement internationaliste, dès lors que les réflexions qui y sont menées dépassent le cadre technique de la discipline pour embrasser des thématiques plus universelles sur la justice, les valeurs et les objectifs du droit.
Retrouvez cet ouvrage en librairie dès à présent.